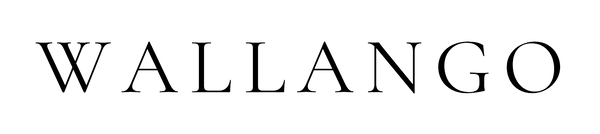Kawanabe Kyōsai : le génie frondeur à l'origine des premiers mangas
Partager
Peintre démoniaque, caricaturiste inspiré, satiriste sans compromis, Kawanabe Kyōsai (1831-1889) est une figure à part dans l'histoire de l'art japonais. Contemporain des bouleversements politiques et sociaux de la fin de l'ère Edo et du début de l'ère Meiji, il a su conjuguer technique classique, imagination débridée et critique sociale dans une œuvre polymorphe, à la fois drôle, effrayante et subversive. Tour à tour vénéré, censuré, oublié puis redécouvert, Kyōsai fascine autant par ses dessins que par sa vie faite d'excès et d'excentricités. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des ancêtres du manga moderne.
Biographie et anecdotes
Né en 1831 à Koga, dans la province de Shimōsa (actuelle préfecture de Chiba), Kyōsai montre très tôt un talent pour le dessin. À neuf ans, il est admis dans l'école officielle Kanō, où il apprend les techniques académiques chinoises et japonaises. Il quitte cependant rapidement ce cadre strict pour se tourner vers des influences plus populaires : l'art des estampes ukiyo-e, les caricatures, le folklore.
L'un de ses premiers coups d'éclat est son arrestation par les autorités pour avoir réalisé des caricatures politiques. Sous le régime du shogunat, toute critique était dangereuse, et Kyōsai paya cher sa verve satirique. Cela ne l'empêcha pas de continuer à produire des œuvres provocantes, souvent sous des pseudonymes ou de façon anonyme.
Kyōsai était aussi célèbre pour son goût de la boisson. On raconte qu'il pouvait peindre après avoir bu toute la nuit, en transe, au sol, avec le pinceau entre les orteils. Un témoin occidental, l'architecte britannique Josiah Conder, rapporte que Kyōsai pouvait produire des chefs-d'œuvre spontanés en quelques minutes, dans un état d'exaltation presque chamanique. Conder fut son élève et son ami, et fit beaucoup pour la postérité de l'artiste.
Analyse de son œuvre
L'art de Kyōsai défie les catégories. Il mêle le raffinement de la peinture classique à l'énergie du croquis et à la violence de la satire. Il peint des parades de démons, des grenouilles samouraïs, des squelettes rieurs, des bouddhas ivres, des animaux anthropomorphes en pleine bacchanale. Ses rouleaux et kakemonos racontent des histoires en images, souvent grotesques, drôles, parfois violentes, toujours expressives.
Les cent Démons

Cette estampe de Kawanabe Kyōsai (1831–1889), tirée de la série Kyōsai Hyakki Gadan (« Conversations illustrées sur cent démons »), parodie avec humour et fantaisie la tradition japonaise du Hyakki Yagyō – la "parade nocturne des démons". Loin des représentations effrayantes, Kyōsai imagine une procession burlesque de monstres absurdes, créatures hybrides, objets vivants et spectres grotesques. Son style vif, satirique et débridé, mélange critique sociale, comédie et culture populaire d’Edo.
Kyōsai maîtrise à la perfection l'art du trait, de l'encre et du lavis. Il joue des contrastes, du mouvement, de la tension. Dans sa "Procession infernale", il imagine un cortège de monstres et de fantômes résonnant comme une allégorie politique. Dans "La guerre des grenouilles", il tourne en dérision les codes de la guerre et de l'honneur samouraï.
Son humour noir et sa liberté de ton font de lui un précurseur de la bande dessinée. Contrairement aux estampes ukiyo-e traditionnelles, ses images racontent des scènes complexes, avec une temporalité interne, un mouvement narratif. Il préfigure ainsi la narration graphique propre au manga.
Bestiaire fantasque : grenouilles, créatures et chats chez Kyōsai
Kyōsai excelle dans l’art d’animer les animaux. L’un de ses motifs les plus célèbres est celui des grenouilles anthropomorphes, comme dans Fûryû kaeru ôgassen no zu (« Bataille à la mode des grenouilles »), une parodie truculente des combats de samouraïs. Les batraciens, armés de lances et vêtus de kimonos, s’affrontent dans une mise en scène à la fois comique et virtuose.
Dans un croquis plus intime, il représente des grenouilles dansant en rond, drapées de feuilles de lotus, au son du shamisen et du tambour. Cette scène burlesque témoigne de sa tendresse pour les marges du vivant, son œil espiègle et son génie du mouvement.

Au-delà des grenouilles, Kyōsai peuple son œuvre de yōkai, esprits du folklore japonais. Certains sont repris du répertoire classique — tengu, oni, kappa — mais il en invente d'autres, ou les déforme à sa guise, dans un esprit de création carnavalesque. Il s’inscrit dans la tradition d’hyakki yagyō (la parade nocturne des cent démons), qu’il modernise avec une veine satirique et une énergie débridée.
Autre motif récurrent : les chats. Parfois sages, parfois déchaînés, ils apparaissent dans ses caricatures comme doubles moqueurs des humains. Dans certaines œuvres, on les voit jouer de la musique, faire la fête, ou encore se battre — toujours avec un regard amusé sur la société japonaise.
Ce bestiaire hybride, oscillant entre tendresse et grotesque, est une des signatures les plus reconnaissables de Kyōsai. Il y mêle humour, observation fine et irrévérence, dans une jubilation graphique rare.

Kyōsai, ancêtre du manga
Si Hokusai est souvent présenté comme le "père du manga" en raison de ses fameux carnets de croquis (Hokusai Manga), Kyōsai est plus proche, dans l'esprit et dans la forme, de ce que nous appelons aujourd'hui manga. Ses dessins, souvent composés en séries, pleins de mouvement, de déformation expressive, d'humour absurde ou noir, annoncent clairement les codes du manga moderne.

Il fut l'un des premiers à faire de la caricature une arme politique et artistique dans le Japon moderne. Il s'inspire des journaux illustrés occidentaux, tout en développant un style typiquement japonais, fondé sur la tradition graphique du toba-e (dessins humoristiques déjà narratifs). Il ouvre ainsi la voie à toute une génération d'artistes qui, au XXe siècle, feront du manga une industrie culturelle majeure.
Popularité au Japon et à l'étranger
Du vivant de Kyōsai, sa popularité fut paradoxale. Adulé dans certains cercles populaires, il était marginalisé par les institutions, en raison de son esprit frondeur et de son style perçu comme outrancier. L'ère Meiji, soucieuse de respectabilité et de modernisation, voyait d'un mauvais œil ses fantasmagories subversives.
En revanche, son talent fut rapidement reconnu par les Occidentaux présents au Japon, comme Josiah Conder, qui collectionna ses œuvres et publia un livre sur lui. Les musées britanniques, français et américains ont préservé nombre de ses dessins.
Au Japon, il faudra attendre le XXe siècle pour qu'il soit pleinement réhabilité. Aujourd'hui, le Kawanabe Kyōsai Memorial Museum à Saitama lui est consacré. Des expositions majeures, notamment au British Museum (2022), ont remis en lumière son génie. Il inspire désormais artistes et mangakas, qui reconnaissent en lui un ancêtre spirituel.
Conclusion
Kawanabe Kyōsai incarne la figure de l'artiste libre, rebelle et visionnaire. Il a su capter l'esprit de son temps tout en préfigurant des formes nouvelles d'expression graphique. Son goût du grotesque, son humour caustique, sa virtuosité technique et sa façon de raconter en images font de lui un chaînon essentiel dans l'histoire du manga.
Plus qu'un illustrateur, Kyōsai est un conteur démoniaque, un esprit libre dans un Japon en mutation, et l'un des artistes les plus fascinants de son époque. Il mérite pleinement d'être redécouvert et reconnu comme l'un des précurseurs majeurs de la culture visuelle japonaise moderne.