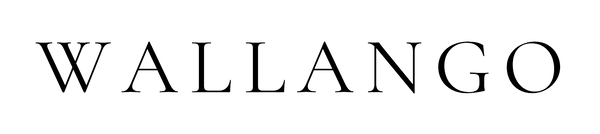The Most Beautiful Natural History Plates: The Pioneers
Partager
Du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle, des pionniers comme Conrad Gessner, Maria Sibylla Merian, Ulisse Aldrovandi, Anselmus Boetius de Boodt ou encore Georges-Louis Leclerc de Buffon ont transformé notre manière de voir le monde naturel.
Leurs ouvrages n’étaient pas de simples livres, mais de véritables aventures éditoriales, réunissant savants, explorateurs et illustrateurs de talent — parfois réunis en une seule personne — pour produire des images à la fois précises, pédagogiques et d’une grande beauté.
L’illustration d’histoire naturelle désigne les représentations de plantes et d’animaux réalisées dans un but d’observation et d’étude. Du Moyen Âge au XIXᵉ siècle, le style, l’intention et la symbolique de ces images ont profondément évolué — évolution mise en valeur par l’exposition du Morgan Library & Museum Picturing Natural History: Flora and Fauna in Drawings, Manuscripts, and Printed Books.

Breyter Indianischer Pfeffer Leonhart Fuchs
Les premiers exemples connus n’étaient pas destinés à l’art au sens moderne, mais à l’utilité pratique : dans l’Antiquité, des traités médicaux illustrés servaient à identifier les plantes aux vertus thérapeutiques. Au Moyen Âge, les artistes recopiaient souvent ces images sans observer directement la nature, ce qui donnait des formes très stylisées, parfois à peine ressemblantes. Ce n’est qu’à la Renaissance, avec par exemple le Livre d’Heures peint pour Catherine de Clèves (vers 1440), que la flore et la faune commencèrent à être représentées avec un souci du réalisme.
L’Âge des Grandes Découvertes bouleversa la donne. Au XVIᵉ siècle, l’arrivée en Europe de plantes et d’animaux inconnus des auteurs antiques obligea les illustrateurs à travailler d’après nature. Les premiers herbiers imprimés, comme le De historia stirpium de Leonhart Fuchs (1542), témoignent de ce tournant vers l’exactitude naturaliste. Aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, artistes-explorateurs et naturalistes collaborèrent étroitement, chacun apportant son savoir ou son regard dans une fusion de science et d’art qui posa les bases de l’âge d’or de l’illustration naturaliste.
Conrad Gessner – Historiae Animalium (1551–1558)
L’ouvrage monumental de Conrad Gessner, Historiae Animalium, constitue une véritable fondation de la zoologie moderne. Il s’agit d’une encyclopédie naturaliste — riche en descriptions, usages médicinaux ou littéraires, noms dans plusieurs langues — accompagnée de gravures et bois coloriés.
Les illustrations, parfois signées Lucas Schan, témoignent d’un désir précoce de représenter les animaux dans leur apparence réelle.

Planches de “Bird of Paradise” tirées de l’Historiae Animalium (Conrad Gessner, 1551-1558). Illustrations peu communes en leur temps, servies par un style à la fois précis et enchanteur.
Ulisse Aldrovandi – Monstrorum Historia et De Animalibus (fin XVIᵉ – début XVIIᵉ s.)
Souvent surnommé le « père des études d’histoire naturelle », Ulisse Aldrovandi constitua une immense collection de spécimens et fit produire plus de 3 000 illustrations sous sa direction.
Même s’il n’était pas toujours l’illustrateur, il supervisait le travail d’artistes qui dessinaient d’après nature. Ses ouvrages, parfois peuplés de « monstres » imaginaires, reflètent à la fois la soif de connaissance et la fantaisie de la Renaissance
Guillaume Rondelet – Libri de Piscibus Marinis (1554–1555)
Médecin et professeur à Montpellier, Guillaume Rondelet réalisa l’un des premiers traités complets sur les poissons et la vie marine.
Les gravures, exécutées par des maîtres graveurs travaillant en lien étroit avec ses observations, se distinguent par leur précision. Ici, naturaliste et illustrateurs travaillaient main dans la main : Rondelet apportait le savoir, les graveurs en assuraient la traduction visuelle.
Anselmus Boetius de Boodt – Gemmarum et Lapidum Historia (1609)
Médecin et naturaliste flamand, Boetius de Boodt est surtout connu pour ses travaux sur les minéraux et les pierres précieuses. Ses planches, aux détails d’une finesse joaillière, rappellent que l’histoire naturelle s’intéresse aussi aux richesses minérales de la Terre. Il a également documenté la faune de la ménagerie de l’empereur Rodolphe II.
Marcus Elieser Bloch – Ichthyologie (1782–1795)
Médecin et ichtyologiste allemand, Bloch produisit l’un des plus beaux ouvrages sur les poissons jamais imprimés. En collaborant avec graveurs et coloristes, il réussit à rendre l’éclat des écailles et la posture naturelle des espèces.
À la fin du XVIIIᵉ siècle, les techniques de gravure et de mise en couleur permettaient un réalisme inédit.

Xiphias Gladius, The Sword Fish.
Maria Sibylla Merian – Metamorphosis Insectorum Surinamensium (1705)
Maria Sibylla Merian est une figure rare — femme, naturaliste, illustratrice — dont le regard porté sur les insectes de Suriname fut à la fois scientifique et profondément lyrique. Elle observe méticuleusement la métamorphose des papillons, la vie des amphibiens, bien loin des idées reçues, et ses planches restituent ces mondes avec une grâce inouïe .
Dans ces planches, Merian va au-delà de l’observation : elle compose, comme une poétesse de la nature, le vivant dans ses moindres détails. Sa technique de contre-épreuve donne une douceur inédite aux contours, intensifiant le trait d’un rendu remarquable.

---
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon – Histoire naturelle (1749–1788)
Buffon réinvente la nature en l’écrivant à nouveau : son Histoire naturelle balaye non seulement les animaux, mais aussi les plantes, minéraux, et la physique. Les illustrations de Jacques de Sève, gravées pour les volumes sur les quadrupèdes, expriment une sensibilité expressive — les animaux, comme les chauves-souris ou paresseux, semblent presque humains.

Ces premières planches naturalistes incarnent l’alliance naissante entre observation méticuleuse, narration visuelle et curiosité poussée. Gessner inventorie un monde qu’on ose à peine imaginer ; Merian l’habite de formes et de couleurs ; Buffon en polit la vision avec élégance et émotion.
Cette quête d’allier exactitude scientifique et sensibilité artistique trouve son apogée au XIXᵉ siècle, où l’impression en couleur et les talents des grands illustrateurs porteront l’image naturaliste à son « âge d’or »...