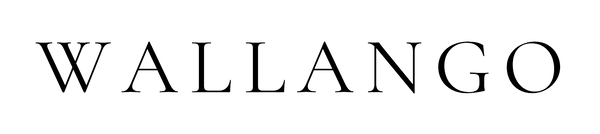La confrérie préraphaélite
Partager
Une révolution artistique à l'ère Victorienne
En 1848, à Londres, un groupe de jeunes artistes décide de bousculer les conventions de l’art académique victorien. Révoltés par les règles figées de la Royal Academy, ils fondent la Confrérie Préraphaélite (Pre-Raphaelite Brotherhood, PRB). Leurs noms : Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt et John Everett Millais. Leur ambition : revenir à un art sincère, détaillé, inspiré du Moyen Âge, de la nature et de la littérature. Leur révolte artistique, marquée par le réalisme et la spiritualité, bouleversera durablement l’histoire de l’art.
Une rupture avec l’académisme : retour à la vérité picturale
Dans l’Angleterre victorienne, l’art officiel privilégie des scènes historiques idéalisées, des compositions classiques inspirées de Raphaël. Les Préraphaélites rejettent cet idéal artificiel. Leur nom affirme leur volonté de retrouver la pureté des maîtres italiens d’avant Raphaël, comme Fra Angelico ou Botticelli, dont ils admirent les couleurs vives, les détails minutieux et l’expression directe de l’émotion.
Dante Gabriel Rossetti rencontra Millais et Hunt à la Royal Academy, où, déçus par l’enseignement académique, ils préféraient étudier ensemble un recueil de gravures des fresques du Camposanto monumental de Pise, œuvres de maîtres italiens comme Orcagna ou Benozzo Gozzoli.

Buffalmacco, Jugement dernier (Camposanto monumentale).
À leurs yeux, l’art doit exprimer la vérité – même choquante – plutôt que flatter les conventions. Ils peignent donc avec une grande précision naturaliste, des décors réalistes et des émotions humaines brutes.
Le scandale du réalisme : Millais et Le Christ dans la maison de ses parents
En 1850, John Everett Millais expose Le Christ dans la maison de ses parents, une scène religieuse traitée de manière résolument réaliste. Marie y est une femme fatiguée, les outils de Joseph traînent, le jeune Jésus s’est blessé à la main. Le tableau choque profondément l’establishment.
Charles Dickens lui-même publie une critique féroce, qualifiant l’enfant Jésus de « garçon hideux, au cou tordu, pleurard, roux, en chemise de nuit ».
Ce scandale révèle l’ampleur de la rupture : les Préraphaélites n’embellissent pas la foi, ils la montrent dans toute sa dimension humaine. Cette approche audacieuse ouvre la voie à une peinture plus vraie, plus ancrée dans la réalité.

La femme préraphaélite : muse, victime, ensorceleuse
Très vite, la figure féminine devient centrale dans l’imaginaire préraphaélite. Longs cheveux, teint pâle, regard songeur ou extatique : ces femmes sont à la fois muses, amoureuses sacrifiées, symboles de beauté dangereuse ou allégories spirituelles. On les retrouve dans de nombreuses œuvres inspirées de la littérature, comme Ophélie de Millais (1852), où l’héroïne de Shakespeare flotte, noyée dans une rivière, entourée de fleurs peintes avec une minutie obsédante.
Ces représentations mêlent érotisme subtil, mélancolie et mysticisme. Elles fascinent par leur puissance visuelle et leur ambiguïté symbolique.

Sir John Everett Millais, Ophélie (1851-1852) Tate
Les sources littéraires : Shakespeare, Dante, Boccace et autres
Les Préraphaélites puisent abondamment dans la littérature, ancienne comme contemporaine. Leurs tableaux traduisent en image des scènes célèbres ou oubliées, mêlant érudition et émotion :
- Hamlet (Shakespeare) : Ophélie, peinte par Millais ou Waterhouse
- La Tempête (Shakespeare) : Miranda (Waterhouse), Ferdinand attiré par Ariel (Millais)
- Vita Nuova (Dante) : Beata Beatrix (Rossetti), vision d’une femme aimée transfigurée par la mort
- Le Décaméron (Boccace) : Isabelle (Millais), Isabelle et le pot de basilic (Hunt)
- Hérode et Mariamne (Voltaire) : Mariamne quittant le tribunal d’Hérode (Waterhouse)
Ces sujets permettent aux artistes de combiner narration, symbolisme et expression émotionnelle intense. Chaque œuvre devient un poème visuel.

Ferdinand attiré par Ariel, John Everett Millais
L’univers médiéval et mythologique : chevaliers, nymphes et sortilèges
Le Moyen Âge et la mythologie sont au cœur de l’imaginaire préraphaélite. Les artistes revisitent les légendes arthuriennes, les récits antiques et les ballades romantiques avec un sens du détail inégalé et une intensité dramatique nouvelle.
Exemples emblématiques :
- La Belle Dame Sans Merci (Francis Dicksee, JW Waterhouse)
- Le Chevalier errant (Millais)
- La Chapelle devant les listes (Rossetti)
- Lady Godiva (John Collier)
- Ondine, Ulysse et les Sirènes, Pandore, Danaïdes (John William Waterhouse)
Ces œuvres ne se contentent pas d’illustrer le passé : elles en révèlent la puissance émotionnelle et la résonance symbolique dans une époque en pleine mutation.

Lady Godiva , John Collier (1897)

Hylas et les nymphes , John William Waterhouse

Miranda , John William Waterhouse
 La Belle Dame Sans Merci, Francis Dicksee, v. Musée d'art et galerie de Bristol
La Belle Dame Sans Merci, Francis Dicksee, v. Musée d'art et galerie de Bristol
Plus qu’un style, un mouvement artistique global
Le PRB dépasse rapidement le cadre de la peinture. Rossetti est aussi poète ; sa sœur, Christina Rossetti, devient une voix majeure de la poésie victorienne. William Morris, proche du groupe, développe une vision de l’art total à travers le mouvement Arts and Crafts, prônant le retour à l’artisanat, au beau dans le quotidien, à l’objet utile et esthétique.
Leur influence s’étend à l’illustration, à l’édition, à la tapisserie, au mobilier : les Préraphaélites ont redéfini ce que pouvait être une vie artistique.
Une postérité durable : du symbolisme à l’Art nouveau
Malgré les critiques initiales, les Préraphaélites finissent par s’imposer. Dans les années 1860, une seconde vague émerge autour de Rossetti et Burne-Jones, avec un style plus sensuel, plus symboliste. Cette transition ouvre la voie à des mouvements majeurs comme le symbolisme européen ou l’Art nouveau.
Edward Robert Hughes, élève de Holman Hunt, perpétue l’héritage préraphaélite au tournant du XXe siècle.
Leur souci du détail, leur goût pour la couleur, leur alliance entre poésie et engagement visuel ont profondément marqué l’histoire de l’art occidental.
À explorer
Explorez les galeries virtuelles des chefs-d'œuvre du PRB à la Tate Britain
William Holman Hunt et son « fils dans l'art » préraphaélite Edward Robert Hughes