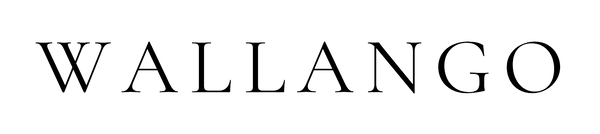William Morris: The Forgotten Writer Who Inspired Tolkien and Dreamed of a Fairer World
Partager
Quand on pense à William Morris (1834–1896), on imagine généralement ses papiers peints floraux, ses tapisseries luxuriantes et son rôle central dans le mouvement Arts and Crafts. Son héritage est devenu synonyme d’artisanat raffiné, de résistance artistique à l’industrialisation et d’une esthétique sophistiquée. Mais Morris était aussi un écrivain passionné — poète médiéviste, romancier utopique, traducteur de sagas nordiques et penseur politique. À une époque où les débats sur le capitalisme, la décroissance et la société de consommation reviennent sur le devant de la scène, redécouvrir William Morris revient à rencontrer l’un des tout premiers “alter-mondialistes” de l’ère industrielle.**


 Cette ambition de créer des mondes trouve une expression concrète dans The Sundering Flood. Pour la première fois dans la littérature de fantasy, Morris conçoit une géographie entièrement cartographiée, décrivant avec précision villes, montagnes et rivières qui structurent la quête de ses personnages. Même si aucune carte illustrée n’a survécu aux premières éditions, la cohérence interne de cette géographie soutient toute la narration. C’est une méthode que Tolkien adoptera et perfectionnera : commencer non par l’intrigue, mais par la carte, et laisser le monde dicter l’histoire.
Cette ambition de créer des mondes trouve une expression concrète dans The Sundering Flood. Pour la première fois dans la littérature de fantasy, Morris conçoit une géographie entièrement cartographiée, décrivant avec précision villes, montagnes et rivières qui structurent la quête de ses personnages. Même si aucune carte illustrée n’a survécu aux premières éditions, la cohérence interne de cette géographie soutient toute la narration. C’est une méthode que Tolkien adoptera et perfectionnera : commencer non par l’intrigue, mais par la carte, et laisser le monde dicter l’histoire.

---
Un poète médiéval parlant au XIXe siècle
Son premier recueil de poèmes, The Defence of Guenevere (1858), s’inspire de la légende arthurienne. Son langage est étonnamment moderne, brut et immédiat. Morris rejette le style ornemental de ses contemporains victoriens au profit d’une poésie d’incarnation et de souffle — presque théâtrale.

Ce poème s’inscrit dans un mouvement artistique et littéraire plus large, connu sous le nom de Renaissance arthurienne, étroitement lié aux artistes préraphaélites. À l’époque victorienne, des auteurs comme Alfred Tennyson, Matthew Arnold et William Morris ont cherché à réinvestir et réinterpréter les thèmes médiévaux — en particulier ceux de la "Matière de Bretagne" (les légendes arthuriennes).
Contrairement aux relectures moralisantes des récits arthuriens par Tennyson ou Arnold, Morris propose dans ce poème une vision sensuelle et profondément humaine de l’amour. En filigrane, son œuvre reflète les grands débats sociétaux de son temps : droits de propriété, éducation, divorce, suffrage féminin, accès à l’emploi.
Dans The Defence of Guenevere, Morris met en scène une femme libre et autonome, qui pour la première fois prend la parole pour justifier sa relation avec Lancelot. À travers cette représentation audacieuse, il s’éloigne de l’image archétypale de la reine prisonnière des attentes courtoises ou politiques. Guenièvre devient ici un personnage à part entière, doté de complexité émotionnelle et d’une réelle capacité d’agir, incarnant une nouvelle vision moderne de la féminité.

Lancelot and Guinevere - Herbert James Draper
---
Aux origines de la fantasy : quand Tolkien lisait Morris

Dans les années 1890, William Morris écrit plusieurs romans pionniers comme The Wood Beyond the World (1894), The Well at the World’s End (1896), et The Sundering Flood (publié à titre posthume en 1897). Bien que méconnus du grand public, ces textes posent les bases de la fantasy moderne. On y trouve des royaumes oubliés, des héros en quête initiatique, des femmes magiciennes, et un style volontairement archaïque. L’influence sur Tolkien est indéniable — il cite ouvertement Morris parmi ses sources d’inspiration majeures, aux côtés des sagas nordiques, du Kalevala et de Beowulf.
Au-delà des quêtes et des géographies imaginaires, l’empreinte de Morris se ressent aussi dans la représentation de femmes puissantes et sensuelles — un trait que l’on retrouve chez Tolkien, avec une sensibilité différente. Comme les héroïnes de Morris, Galadriel ou Lúthien chez Tolkien ne sont ni passives ni décoratives : elles façonnent les destins, imposent le respect et incarnent une autorité mystérieuse et éthérée.
Mais Morris n’écrivait pas seulement pour divertir. Il construisait des mondes entiers, cherchant une réalité immersive et organique où le récit portait une vision plus profonde de la dignité humaine et de la beauté naturelle. Son langage archaïsant reflétait la noblesse simple de ses personnages, loin du monde industriel victorien qu’il critiquait. Son sens du détail, sa préférence pour la lenteur narrative plutôt que pour l’action spectaculaire, ont donné naissance à une œuvre exigeante mais envoûtante.
 Cette ambition de créer des mondes trouve une expression concrète dans The Sundering Flood. Pour la première fois dans la littérature de fantasy, Morris conçoit une géographie entièrement cartographiée, décrivant avec précision villes, montagnes et rivières qui structurent la quête de ses personnages. Même si aucune carte illustrée n’a survécu aux premières éditions, la cohérence interne de cette géographie soutient toute la narration. C’est une méthode que Tolkien adoptera et perfectionnera : commencer non par l’intrigue, mais par la carte, et laisser le monde dicter l’histoire.
Cette ambition de créer des mondes trouve une expression concrète dans The Sundering Flood. Pour la première fois dans la littérature de fantasy, Morris conçoit une géographie entièrement cartographiée, décrivant avec précision villes, montagnes et rivières qui structurent la quête de ses personnages. Même si aucune carte illustrée n’a survécu aux premières éditions, la cohérence interne de cette géographie soutient toute la narration. C’est une méthode que Tolkien adoptera et perfectionnera : commencer non par l’intrigue, mais par la carte, et laisser le monde dicter l’histoire.En ce sens, Morris a montré à Tolkien — et aux générations suivantes — que la fantasy n’est pas une fuite du réel, mais un acte de création éthique et esthétique, un désir d’harmonies perdues et une tentative de retrouver du sens à travers des mondes inventés.
---
Échos arthuriens chez les femmes de Tolkien
Si William Morris et Tolkien se sont tous deux inspirés des sources médiévales, l’influence de figures arthuriennes spécifiques varie selon leurs œuvres. Galadriel, reine lumineuse et ancienne chez Tolkien, doit plus aux archétypes mythologiques des Valkyries nordiques ou des voyantes celtiques qu’à des personnages comme Élaine d’Astolat.
Cependant, des traces de l’inspiration arthurienne subsistent. Des figures comme Éowyn et Arwen rappellent davantage Élaine — femmes nobles marquées par l’amour, la perte et le sacrifice. Le désir de gloire d’Éowyn et sa confrontation avec la mort font écho à l’héroïsme mélancolique de la Dame de Shalott, tandis que le choix d’Arwen de renoncer à l’immortalité pour Aragorn évoque la beauté tragique des romances médiévales.
À travers ces échos, Tolkien transforme l’idéal médiéval de la “dame tragique” en portraits complexes d’agentivité, de courage et de douleur.

The death of Elaine of Astolat, Sophie Anderson.
---
Rêves, reflets et germes de la fantasy
The Lady of Shalott d’Alfred Tennyson incarne la profonde mélancolie de la séparation : une femme condamnée à ne voir le monde qu’à travers des reflets, tissant des images d’une vie qu’elle ne peut toucher. Son destin résonne chez les artistes et écrivains du XIXe siècle, de plus en plus aliénés par l’ère industrielle. Pourtant, là où Tennyson voyait l’isolement tragique, William Morris commençait à imaginer des passerelles au-delà du miroir.
À travers ses rêveries médiévales et ses visions utopiques, Morris ne fuyait pas le présent — il l’affrontait autrement. Dans News from Nowhere, ou dans ses romances comme The Well at the World's End, il crée des mondes où la beauté, l’artisanat et la dignité humaine ne sont pas des idéaux perdus, mais les fondements de l’existence.
Son médiévisme n’est jamais de la simple nostalgie. Comme le miroir maudit de la Dame de Shalott, la modernité industrielle n’offre qu’un reflet déformé de la richesse véritable de la vie. La fantasy, pour Morris, devient un moyen de briser le sortilège — d’imaginer des sociétés fondées sur l’harmonie, l’égalité et la joie.
À ce titre, Morris apparaît non seulement comme un précurseur de Tolkien et de la fantasy moderne, mais aussi comme un visionnaire convaincu que rêver d’autres mondes est un acte de résistance — et d’espérance.